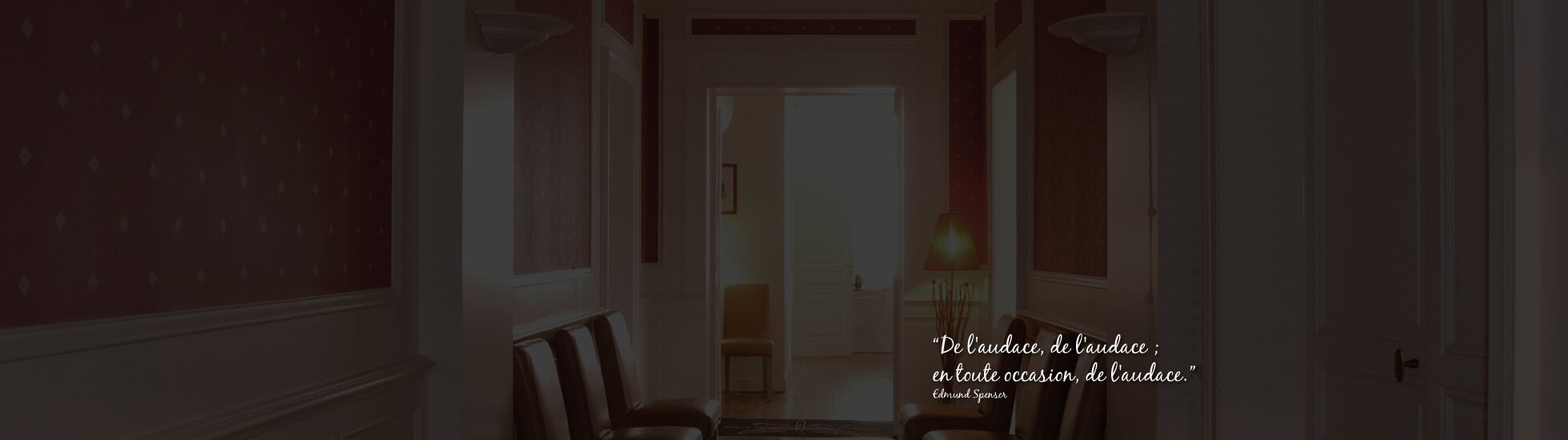Requalification de la relation contractuelle entre un livreur et une plate-forme numérique de commande de repas en contrat de travail
Depuis quelques années, un nouveau genre de cycliste parcoure nos grandes villes.
Ils arpentent les rues accompagnés de sacs à dos cubiques isothermes sur lesquels on peut apercevoir inscrit : « Deliveroo », « Uber eats », ou encore « Take Eat Easy ».
Ces cyclistes sont chargés de livrer, du restaurant au domicile du client, les repas commandés par ce dernier.
La différence avec les livreurs « classiques » de repas commandés est qu’ils ne sont pas salariés du restaurant dont le plat a été commandé.
Ces coursiers d’un nouveau genre ont un contrat de prestation de service avec des sociétés bien connues comme« Deliveroo », « Uber eats » ou encore « Take Eat easy ». Ces sociétés se traduisent pas une plate-forme numérique et une application permettant de mettre en relation 3 acteurs : les clients passant commande, les restaurateurs partenaires, et les livreurs.
Autrement dit, ces livreurs au statut indépendant vont chercher de(s) plat(s) commandé(s) au sein des différents restaurants partenaires de la ville pour les livrer ensuite au domicile du client.
La livraison de repas a donc, à son tour, été victime de l’ubérisation. La problématique qui a émergé par la suite est celle de la qualification de la relation contractuelle entre le coursier et la plate-forme. Bien qu’en l’espèce il s’agisse d’un contrat de prestation de service, il est admis de manière constante que la volonté des parties ou encore la qualification qu’ils ont attribués à la relation contractuelle les liant importe peu. Il revient au juge, si nécessaire, de la requalifier à la lumière des conditions de fait dans lesquelles est exercées l’activité du travailleur.
La question qui s’est posée en jurisprudence était ainsi de savoir si dans les faits, un lien de subordination liait le livreur à la plate-forme, de sorte que dans la positive, les deux parties seraient liés par un contrat de travail.
Il est constant que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc. 13/11/93, n°94-13187).
Il est intéressant de noter que la Cour d’appel de Paris par deux arrêts (CA Paris 20/04/17 et 09/11/17) avait tranché sur ce sujet en déboutant un livreur à vélo de sa demande de requalification en contrat de travail de sa relation contractuelle avec les plate-formes « Take Eat Easy » et « Deliveroo ».
La Cour avait justifié cette décision car premièrement, le livreur n’était pas tenue à une obligation de non-concurrence et d’exclusivité et deuxièmement, elle avait expliqué que le coursier était libre de :
- Proposer ou non ses services ;
- Choisir ses périodes de prestation (jours et horaire) sans être soumis à une quelconque durée du travail ;
- Choisir la zone géographique dans laquelle il propose ses services mais également l’itinéraire pour livrer ;
- Utiliser son propre vélo.
Pour ces deux raisons, le lien de subordination n’était pas, selon elle, caractérisée.
Pour autant, ce n’est pas la solution pour laquelle a opté la chambre sociale de la Cour de cassation (Soc. 28/11/18, n°17-20079).
Par sa décision en date du 28 novembre 2018, elle a considéré que le lien de subordination était réel en raison de l’existence de pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction caractérisés par :
Tout d’abord, le fait que l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant :
- Le suivi en temps réel par la société de la position du coursier ;
- La comptabilisation du nombre total de kilomètre parcourus par celui-ci.
Mais également, le fait que le salarié avait des pénalités en cas de manquement à ses obligations contractuelles (livrer avec un appareil motorisé, incapacité à réparer une crevaison, insulte à l’égard du client, absence de réponse à son téléphone pendant la période d’intervention, etc…), et aussi, des bonus (en raison du temps d’attente au restaurant ou en cas de dépassement de la moyenne kilométrique des coursiers).
Ainsi, et au regard des faits de l’espèce, telle est désormais la position de la chambre sociale sur la qualification de la relation contractuelle entre un livreur à vélo et une plate-forme numérique de commande de repas : Il s’agit ni plus ni moins d’un contrat de travail.
Et si par aventure, certains pensaient invoquer la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 pour avancer une présomption de non-salariat à l’égard de ces coursiers, la Cour de cassation a d’ores et déjà fait barrage dans sa note explicative, en précisant que bien que le législateur ait esquissé une responsabilité sociétale de ces plate-formes numériques, en prévoyant notamment des garanties minimales pour protéger cette nouvelle catégorie de travailleurs, « il ne s’est toutefois pas prononcé sur leur statut juridique et n’a pas édicté de présomption de non-salariat ».
Anna Sorin, Elève avocate au cabinet Rouxel-Chevrollier